Biologie végétale
Morphologie végétale
Les fougères
Accueil » Morphologie végétale » Ptéridophytes » Les fougères
Introduction
Les fougères présentent un type de reproduction sexuée fort voisin de celui des prêles, jusque dans les détails, bien que les deux groupes semblent avoir évolué séparément depuis plus de 300 millions d’années.
L’appareil végétatif aérien paraît souvent plus développé chez les fougères, mais ce caractère n’a qu’une importance accessoire quand on sait que des Sphénophytes fossiles, tels les Calamites, pouvaient atteindre la taille d’arbres de 30 m de haut.
On notera cependant que, pour la première fois au cours de l’évolution, l’appareil foliaire peut déployer des surfaces considérables (mégaphylles) grâce à un système de nervuration en nombreux cordons vasculaires anastomosés qui prennent leur origine au niveau du cylindre central de la tige où des fenêtres foliaires sont ménagées comme chez les plantes supérieures. Il s’agit donc d’un caractère évolué.
L’exemple sur lequel s’appuiera la démonstration est celui de la fougère mâle (Dryopteris filix-mas).
 Photo 1 : Sores de la fougère mâle, recouvertes par une indusie réniforme
Photo 1 : Sores de la fougère mâle, recouvertes par une indusie réniforme
Pour en savoir plus
1. Appareil végétatif
A. Organographie
Chez la fougère mâle (Dryopteris filix-mas), un rhizome porte chaque année une rosette de frondes (= feuilles) aériennes. Celles-ci croissent en déroulant une espèce de crosse (Photo 2) qui n’est rien d’autre que la fronde dont les segments sont repliés.
 Photo 2 : Crosses de jeunes fougères
Photo 2 : Crosses de jeunes fougères
Le rhizome, comme le pétiole et le rachis des frondes, est couvert d’écailles d’origine épidermique. Sa croissance est assurée par une cellule unique tétraédrique, comme chez les Bryophytes.
La jeune racine, issue de l’embryon, disparaît précocement et est remplacée, sur le rhizome, par des racines adventives qui possèdent également une cellule apicale tétraédrique.
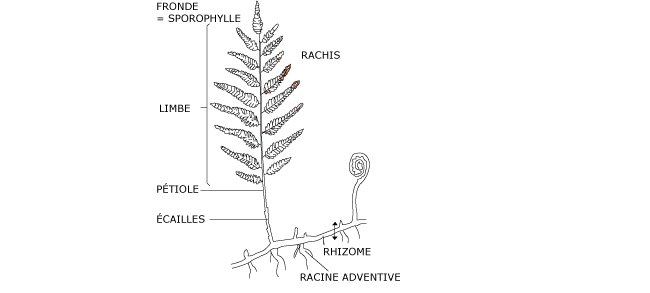 Figure 1 : Appareil végétatif de Dryopteris filix-mas
Figure 1 : Appareil végétatif de Dryopteris filix-mas
B. Anatomie
Une coupe transversale dans le rhizome montre la disposition des tissus conducteurs sous la forme d’une polystèle, c’est-à-dire d’un ensemble de cordons (protostèles) grossièrement disposés en cercle comprenant un xylème interne complètement encerclé par un anneau de phloème.

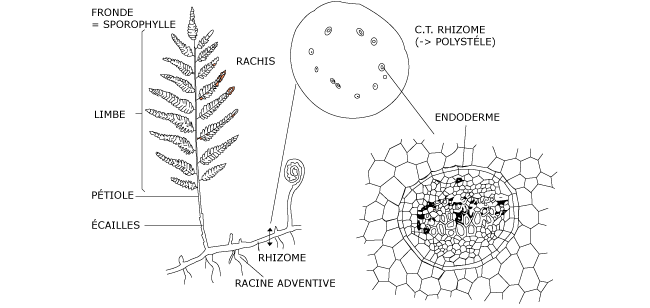 Figure 2 : Coupe transversale du
Figure 2 : Coupe transversale du